Le Prince d'Ottawa : Machiavel Revisité à l'Ère Trudeau
Dans un Canada embrumé par les ombres du pouvoir, cet essai revisite Machiavel au prisme des dix ans libéraux : Trudeau, maître de la peur subtile, brandit virus, climat et armes pour unifier la masse, écho au Prince où "mieux vaut être craint qu'aimé". Locke et Mill y décrient la coercition anti-libérale ; Nietzsche, l'esclavage moral. Avec humour noir, un appel à danser sous la pluie stoïcienne, loin des dupes consentants.
PHILOSOPHIESOCIALISMEMACHIAVEL
Yoann Paridaens
10/7/20257 min read
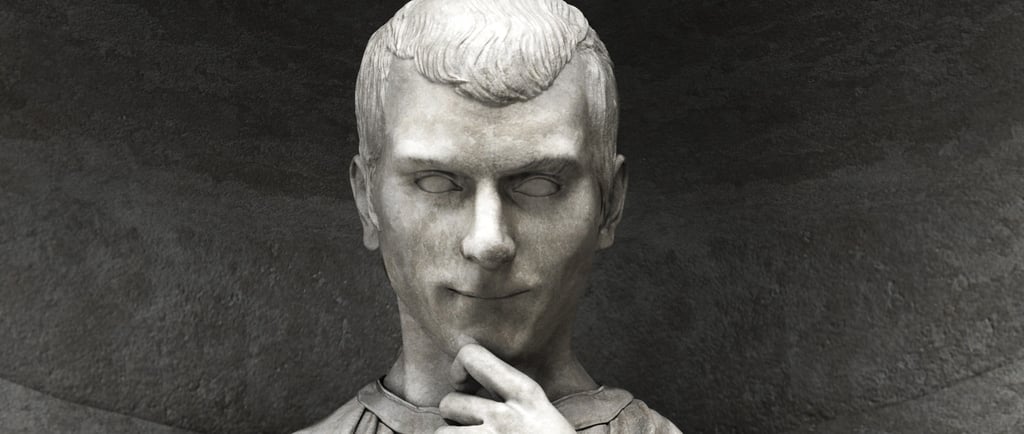
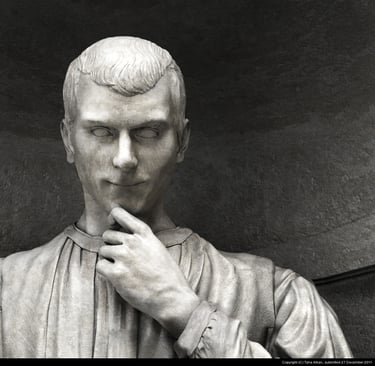
Imaginez un brouillard automnal enveloppant les plaines d'Abraham, non pas en 1759, mais en 2025. Au lieu de canons tonitruants, on entend le bourdonnement discret des notifications push sur les smartphones des Canadiens : alertes climatiques, rappels vaccinaux, et mises en garde contre les "menaces" invisibles qui guettent à chaque coin de rue. C'est dans ce Canada moderne, tissé de pixels et de promesses, que l'ombre de Nicolas Machiavel semble s'allonger. Ce Florentin rusé, qui conseillait aux princes de naviguer les tempêtes du pouvoir avec une main de velours et un gant de fer, trouverait-il en notre système politique un écho troublant de ses maximes ? Depuis une décennie, sous la houlette des libéraux de Justin Trudeau, la gouvernance canadienne a souvent dansé sur le fil entre persuasion et coercition, usant de la peur comme d'un levier subtil pour ancrer le pouvoir. Explorons ce ballet machiavélique, où la crainte collective devient l'alliée discrète des élites, et voyons comment il heurte – ou résonne avec – les grands penseurs de la liberté.
Commençons par le maître lui-même. Machiavel, dans son Prince de 1532, n'était pas un apôtre du mal gratuit, mais un réaliste impitoyable face à la nature humaine. Pour lui, le souverain doit avant tout survivre et prospérer, quitte à sacrifier les illusions morales. "Il est beaucoup plus sûr pour un prince d'être craint que d'être aimé", écrit-il au chapitre XVII, ajoutant avec une pointe d'ironie que "si l'on ne peut être les deux, il vaut mieux être craint qu'aimé". Pourquoi ? Parce que l'amour est volatile, fondé sur des gratitudes éphémères, tandis que la peur – bien dosée – forge une obéissance durable. Pas une terreur paralysante, non : une appréhension calculée, qui fait plier sans briser. Machiavel, inspiré des empereurs romains comme César Borgia, savait que le peuple, ce troupeau malléable, réagit plus aux ombres qu'aux lumières. Et dans ce Canada des années 2015-2025, les libéraux ont-ils, consciemment ou non, exhumé ce manuel antique ? Observons les faits, sans parti pris, en nous appuyant sur les chroniques du temps.
Les dix dernières années au Canada ont été marquées par l'ascension et la consolidation du Parti libéral, porté au pouvoir en 2015 sur une vague de "voies ensoleillées" et de promesses progressistes. Justin Trudeau, avec son charisme de millennial – selfies inclus – a remporté trois élections, dont deux en minorité (2019 et 2021), avant de céder la place en janvier 2025, laissant un legs de divisions profondes et un pays fracturé. Mais comment ce gouvernement, souvent loué pour sa sensibilité sociale, a-t-il maintenu sa poigne sur les rênes ? La réponse réside en partie dans une gouvernance par l'urgence : une série de crises – réelles ou amplifiées – où la peur est brandie comme un bouclier contre l'opposition. Prenons la pandémie de COVID-19, ce tsunami invisible qui a submergé le monde dès 2020. Les libéraux ont imposé des mandats vaccinaux stricts, des confinements prolongés et une rhétorique alarmiste qui peignait les récalcitrants comme des dangers publics. "Nous devons protéger les vulnérables", clamait Trudeau, mais derrière ces mots bienveillants se profilait une stigmatisation : les non-vaccinés comme "menace" à la société, justifiant une surveillance accrue et des restrictions sur les libertés de mouvement. Le point culminant ? Le "Freedom Convoy" de 2022, où des camionneurs ont convergé sur Ottawa pour protester contre les mandats pour les transporteurs transfrontaliers. Loin de dialoguer, le gouvernement a invoqué les Emergencies Act pour la première fois en temps de paix, gelant des comptes bancaires et qualifiant les manifestants de "menace à la sécurité nationale". Ironie du sort : Trudeau accusait les conservateurs de "semer la peur" autour de ces mandats, alors que sa propre administration divisait le pays en "responsables" et "irresponsables".
Ce n'est pas un cas isolé. Sur le front climatique, les libéraux ont érigé la peur en pilier idéologique. Dès 2016, avec la taxe carbone, Trudeau promettait de "combattre la crise climatique urgente", dépeignant un avenir apocalyptique de feux de forêt et d'inondations si l'on n'agissait pas vite. "La menace du changement climatique plane toujours au-dessus du gouvernement de Trudeau", notait-on en pleine pandémie, comme si le virus n'était qu'un prélude à des cataclysmes plus grands. Cette rhétorique, amplifiée par des discours sur "l'adaptation nationale" et des stratégies d'urgence, a justifié des hausses de coûts énergétiques et des régulations contraignantes, souvent sans consensus provincial. Et quand les opposants critiquaient ? Accusés de "tactiques d'intimidation" – mots que Trudeau lui-même employait contre les détracteurs de sa taxe carbone en 2016. Un comble machiavélique : projeter sa propre arme sur l'adversaire pour discréditer les critiques.
Enfin, le contrôle des armes à feu illustre ce schéma avec une clarté chirurgicale. Après la tragédie de Nova Scotia en 2020, où un tireur a semé la mort, le gouvernement a réagi par un gel immédiat sur les armes de poing et un ban sur les fusils d'assaut "style militaire". Louable en surface, mais la communication ? Un déferlement d'images choquantes et de narratifs sur "la violence armée qui menace nos communautés", poussant des réformes comme le Bill C-21 en 2023, qui codifiait ces interdictions. Les libéraux, forts de leur majorité morale, ont ainsi consolidé un électorat urbain terrifié par l'idée d'un "Far West canadien", marginalisant les voix rurales et les chasseurs comme des reliques archaïques. Résultat : un pouvoir maintenu par l'épouvante collective, où la sécurité devient prétexte à la centralisation.
Machiavel applaudirait-il ? Probablement, avec un sourire en coin. Car dans Le Prince, il conseille au souverain d'apparaître miséricordieux, fidèle et humain – tout en agissant autrement si nécessaire. Trudeau, avec ses discours empathiques et ses câlins virtuels, incarne cette façade : un leader "soleil" qui, sous pression, invoque la crainte pour unifier la "masse" contre un ennemi commun, qu'il soit virus, CO2 ou calibre .223. Mais arrêtons-nous un instant pour un éclat d'humour noir : imaginez Machiavel consultant pour un cabinet ministériel, tweetant "Il vaut mieux un lockdown craint qu'un parlement aimé" – le Florentin aurait adoré les algorithmes, ces nouveaux espions du trône.
Pourtant, cette machiavélisme canadien heurte de front les piliers de la philosophie libérale classique, ces penseurs que nous chérissons pour leur défense acharnée de l'individu. John Locke, dans ses Deux Traités du Gouvernement Civil (1689), posait que le pouvoir légitime naît du consentement, non de la coercition : "Le gouvernement n'a pas le droit de détruire, endommager ou marquer de façon permanente le sujet", avertit-il, soulignant que la peur sape le contrat social. Or, quand les libéraux divisent pour régner – opposant citadins et camionneurs, progressistes et conservateurs –, on sent l'ombre de cette violation lockienne. John Stuart Mill, dans De la Liberté (1859), allait plus loin : "La seule fin pour laquelle le pouvoir puisse être légitimement exercé sur un membre de la communauté civilisée, contre sa volonté, est pour prévenir un tort à autrui." Les mandats COVID, justifiés par la "protection collective", flirtent avec la "tyrannie de la majorité" que Mill redoutait, où la peur du "tort" devient excuse pour entraver la liberté personnelle. Et que dire de Friedrich Nietzsche ? Ce prophète de la volonté de puissance, dans Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885), méprisait les "esclaves moraux" qui se soumettent par crainte : "L'homme est une corde tendue entre la bête et le Surhumain – une corde au-dessus d'un abîme." Les tactiques libérales, en cultivant une dépendance à l'État protecteur, risquent de nous laisser pendus, non pas vers l'élévation, mais vers une résignation atrophiante.
Ayn Rand, cette objectiviste farouche, aurait vu dans tout cela un altruisme toxique : le sacrifice de l'individu au collectif, masqué par des vertus factices. Dans La Grève (1957), elle dépeint les looters – ces élites qui pillent la productivité sous couvert de bien commun. "La peur est l'arme des looters", pourrait-on paraphraser, tant les libéraux ont usé de l'épouvante climatique pour taxer, de la terreur pandémique pour mandater, et de l'effroi sécuritaire pour désarmer. Adam Smith, père du libéralisme économique dans La Richesse des Nations (1776), rappellerait que "la crainte de la concurrence est ce qui modère les prix" – mais appliqué à la politique, c'est la concurrence des idées qui tempère le pouvoir. Or, en semant la division, les libéraux ont étouffé ce marché des opinions, préférant un monopole de la narrative officielle.
Les philosophes gréco-romains, ces ancêtres stoïques, nous offrent un contrepoint serein. Sénèque, dans ses Lettres à Lucilius, conseillait : "La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie." Face à la gouvernance par la peur, peut-être est-il temps pour les Canadiens de danser – non en troupeau apeuré, mais en citoyens lucides, réclamant un pouvoir qui inspire plutôt qu'il intimide. Machiavel nous enseigne la réalité ; Locke et Mill, l'idéal. Le Canada des prochaines années choisira-t-il le prince rusé ou le république éclairée ?
En fin de compte, ces dix ans libéraux ne sont pas une tyrannie flagrante, mais un machiavélisme soft, adapté à notre ère démocratique. Ils nous rappellent que la peur, comme un bon vin, enivre vite mais laisse un mal de tête persistant. Pour un pays bâti sur la paix et l'ordre, il serait sage de troquer la crainte contre la confiance – et relire Machiavel non comme un guide, mais comme un miroir. Après tout, même le Florentin savait que "les hommes sont si simples et si obéissants aux nécessités présentes, que celui qui trompe trouvera toujours qui se laisse tromper." La question est : serons-nous les dupes, ou les éveilleurs ?


