La Liberté Oubliée : John Stuart Mill et l'Éveil Québécois contre le Collectivisme
Découvrez "La Liberté Oubliée" : un plaidoyer ardent pour John Stuart Mill et son Essai sur la liberté, adapté au Québec pour briser les chaînes du collectivisme. En écho à Mises et Hayek, cet article dépeint le harm principle comme rempart contre l'État omnipotent, avec exemples québécois piquants – de la Loi 101 aux taxes étouffantes. Humoristique et incisif, il invite à l'émancipation individuelle : "Laissez le marché fleurir comme un érable en mai !"
JOHN STUART MILLLIBERTÉPHILOSOPHIE
Yoann Paridaens
9/30/20256 min read
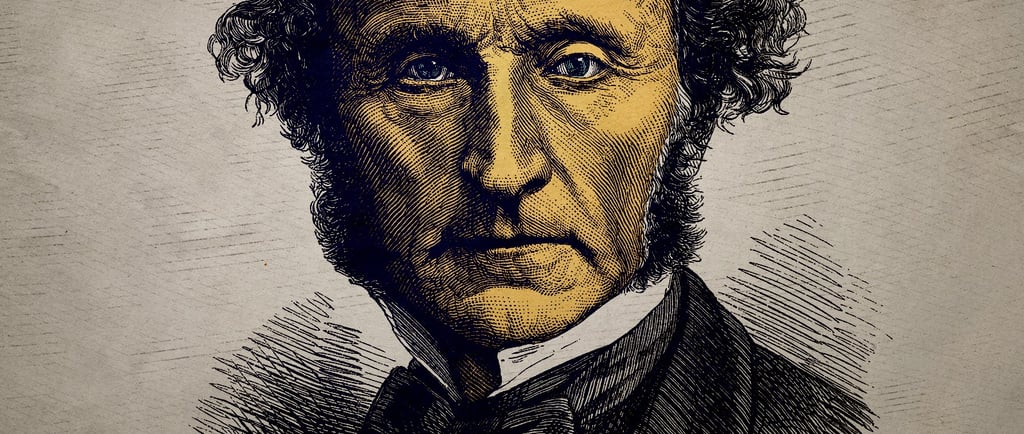
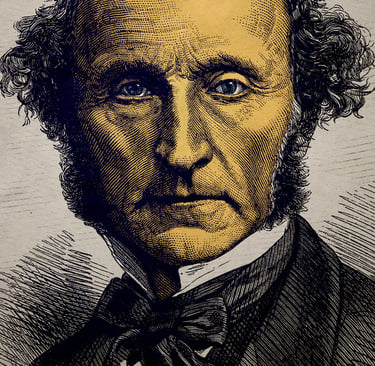
Un matin d'hiver à Montréal, où le vent du Saint-Laurent fouette les rues comme un rappel brutal de la nature impitoyable. Vous sortez pour un café, mais avant même d'atteindre la porte, une avalanche de taxes, de règlements et de subventions gouvernementales semble vous engloutir. Au Québec, cette terre de pionniers farouches, nous avons troqué l'esprit d'indépendance des coureurs des bois pour un État providence qui, bien intentionné, nous berce d'une illusion collective. Et si, pour nous en libérer, nous revenions à un penseur anglais du XIXe siècle qui nous rappelle que la vraie liberté n'est pas un slogan électoral, mais un droit inaliénable de l'individu ? John Stuart Mill, avec son Essai sur la liberté (On Liberty, 1859), n'est pas seulement un pilier de la philosophie libérale ; il est une arme subtile contre la marée collectiviste qui inonde notre belle province. En tant que passionné de l'École économique autrichienne – cette école qui, de Mises à Hayek, défend l'individu contre l'État omnipotent –, permettez-moi de vous guider dans cette redécouverte. Prenez un café (sans taxe carbone, si possible), et lisons ensemble pendant dix minutes : Mill pourrait bien être la clé pour émancipé notre pensée québécoise du carcan socialiste.
Né en 1806 à Londres dans une famille d'intellectuels utilitaristes, il fut éduqué comme un petit prodige par son père James, un philosophe radical qui le fit réciter Homère en grec à l'âge de trois ans. Mill grandit dans l'ombre de Jeremy Bentham, le père de l'utilitarisme, cette doctrine qui mesure le bien par le calcul du plaisir et de la douleur collective. Mais Mill, avec sa sensibilité romantique héritée de sa femme Harriet Taylor, transcenda ce positivisme froid pour infuser une dose d'individualisme ardent. Philosophe, économiste et homme politique, il siégea à la Chambre des communes et défendit les droits des femmes dans L'asservissement des femmes (1869). Son œuvre est un pont entre l'utilitarisme benthamien et le libéralisme classique, mais c'est dans On Liberty qu'il forge son legs immortel : une défense passionnée de la liberté individuelle contre les tyrannies, qu'elles viennent de l'État ou de la majorité.
L'essai, écrit à l'apogée de la révolution industrielle, répond à une question lancinante : comment préserver la liberté dans une société de plus en plus démocratique et égalitaire ? Mill observe que la tyrannie de la majorité – ce troupeau conformiste qui impose ses normes – est plus insidieuse que celle d'un roi absolu. "Le 'peuple' qui exerce le pouvoir n'est pas toujours le même que celui sur lequel il est exercé ; et le 'gouvernement de soi' dont on parle n'est pas le gouvernement de chaque individu par lui-même, mais de chacun par tous les autres", écrit-il avec une clarté acerbe. Ici, Mill diagnostique le mal moderne : la démocratie, sans garde-fous, peut devenir une machine à broyer les dissidents. Pour y remédier, il pose le "principe de préjudice" (harm principle), pierre angulaire de sa philosophie. La liberté individuelle – de pensée, d'expression, de poursuite du bonheur – ne doit être limitée que pour empêcher un tort direct à autrui. "La seule liberté qui mérite ce nom est celle de poursuivre notre propre bien à notre manière, tant que nous ne tentons pas de priver les autres du leur", proclame-t-il. Pas de paternalisme bienveillant, pas d'État qui "sait mieux" pour votre alimentation ou vos choix de vie. Mill n'est pas naïf : il sait que la société progresse par le frottement des idées, par la "liberté de goûts et de poursuites" qui permet à l'individu de s'épanouir. Sans cela, l'humanité stagne dans un marécage de conformisme, comme un sirop d'érable trop épais qui colle les roues de la charrette.
Maintenant, reliez cela à l'École autrichienne, cette tradition que je chéris pour son insistance sur l'individu comme acteur souverain de l'économie et de la société. Ludwig von Mises, le doyen autrichien, verrait en Mill un allié contre le socialisme, qu'il dépeint comme un mirage destructeur. Dans Le Socialisme (1922), Mises tonne : "Toute action rationnelle est d'abord une action individuelle. Seul l'individu pense. Seul l'individu raisonne. Seul l'individu agit". Pour Mises, le collectivisme – qu'il soit marxiste ou étatiste soft – anéantit cette rationalité en substituant le calcul centralisé à l'ordre spontané du marché. Mill, avec son harm principle, préfigure cela : imposer une vision collective du "bien commun" n'est qu'une forme de violence masquée. Imaginez Mises lisant Mill autour d'un feu à Vienne : il rirait peut-être de l'anglicisme du texte, mais applaudirait l'avertissement contre l'État qui, sous prétexte d'égalité, étouffe l'innovation. Et Friedrich Hayek, Nobel d'économie en 1974 et pilier autrichien, n'hésite pas à invoquer Mill pour contrer le collectivisme. Dans ses écrits, Hayek critique l'idée millienne d'un État planificateur bienveillant, arguant que même les intentions pures mènent au totalitarisme. "L'égalité des règles générales du droit et de la conduite est la seule sorte d'égalité qui favorise la liberté et la seule que nous puissions sécuriser sans danger", note-t-il dans The Constitution of Liberty (1960), un écho direct au principe de non-interférence de Mill. Hayek, qui admirait Mill tout en le dépassant, voit en lui un rempart contre la "servitude planifiée" : le collectivisme promet le paradis, mais livre l'enfer bureaucratique.
Pourquoi cette leçon résonne-t-elle si fort au Québec ? Notre histoire est un roman d'émancipation avortée, teinté de collectivisme qui, sous couvert de solidarité, a muselé l'individu. Pensez à la Révolution tranquille des années 1960 : un séisme libérateur qui a sécularisé la société, nationalisé l'hydroélectricité et créé un État providence généreux. Mais, comme l'avertit Mill, cette "majorité" québécoise – avec ses syndicats puissants et ses politiques linguistiques rigides – a parfois versé dans la tyrannie douce. La Loi 101 (1977), symbole de survie culturelle, impose un uniformisme qui frôle le harm principle inversé : elle protège la collectivité francophone, mais au prix de la liberté d'expression des minorités ou des entrepreneurs anglophones. Aujourd'hui, en 2025, le Québec ploie sous un fardeau fiscal parmi les plus lourds en Amérique du Nord – 40 % du PIB en dépenses publiques, selon les données récentes –, avec des subventions à foison pour les industries "vertes" ou culturelles, dictées par Québec. C'est le collectivisme en habit de trappeur : l'État décide qui mérite l'aide, qui innove "correctement". Résultat ? Une génération de jeunes Québécois talentueux qui émigrent vers Toronto ou Silicon Valley, fuyant un système qui, comme le dit Mises avec humour noir, "promet non seulement le bien-être – la richesse pour tous – mais le bonheur universel en amour aussi. Cette partie de son programme a été la source de beaucoup de son attrait". Ah, le socialisme romantique ! Il vend du rêve, mais livre des formulaires en triplicate.
Prenons un exemple concret pour ancrer cela. Imaginez Pierre, un artisan brassicole de la Beauce, qui rêve de lancer une microbrasserie bio. Mill applaudirait : tant que ses bières ne nuisent pas, l'État n'a rien à dire. Mais au Québec, Pierre affronte un labyrinthe réglementaire – permis environnementaux, quotas linguistiques sur les étiquettes, taxes sur les emballages "non durables". C'est le collectivisme en action : une "majorité" qui, via ses élus, impose sa vision écologique ou culturelle, étouffant l'individualité créative. Hayek l'expliquerait par l'ordre spontané : laissez les millions de Pierre innover librement, et l'économie fleurira comme un érable en mai. Au lieu de cela, nous avons un État qui, comme un oncle trop protecteur, vous enveloppe dans de la ouate jusqu'à l'asphyxie.Si Mises gérait le Québec, il abolirait les subventions et laisserait le marché décider si la poutine est un bien culturel ou un plat à emporter !
Pour émancipé cette pensée socialiste et collectiviste qui nous colle à la peau – héritage de la Révolution tranquille et de décennies de modèle Québecois –, Mill offre un antidote philosophique. Relire On Liberty n'est pas un exercice académique ; c'est une déclaration d'indépendance personnelle. Dans un Québec en pleine mutation identitaire, où la "Révolution silencieuse" a cédé la place à un multiculturalisme tendu et à des débats sur la laïcité, le harm principle nous invite à questionner : protège-t-on la collectivité en sacrifiant l'individu, ou l'inverse ? Les autrichiens, objectifs dans leur analyse, nous rappellent que la vraie prospérité naît de la liberté, non de la planification. Comme le résume Hayek dans son éloge voilé de Mill : la civilisation occidentale s'est bâtie sur ces principes de liberté, interchangeables avec la prospérité.
En conclusion, chers Québécois, John Stuart Mill n'est pas un import anglais poussiéreux ; il est un miroir pour notre âme fière mais engourdie. Son Essai sur la liberté nous exhorte à briser les chaînes invisibles du collectivisme : pensez par vous-même, agissez sans entraves, et laissez la société progresser par le génie individuel. Mises et Hayek, ces gardiens autrichiens de la raison, nous soutiennent : le socialisme, même doux, est un leurre qui vole l'âme productive. Relisons Mill autour d'un bon café la maison, et rions de l'absurde : après tout, si l'État gérait nos hivers, il nous imposerait des igloos collectifs ! Éveillons-nous. La liberté n'attend pas les subventions ; elle se conquiert, une pensée à la fois. Qu'en dites-vous ? Prêt à poursuivre votre bien à votre manière ?


